Cupides ou
stupides
(Lettres au président du Syndicat des Médecins
Libéraux)
2/10/06 par ES
Amours barbares
25/11/04 par le Pr H.P. Mosis
VIOQ
L’étude qui fait trembler le corps médical
25/11/04 par ES
La
chimiothérapie «maison» du docteur POTLATSCH,
20/11/04
par ES
L'association nous a baptisé "section".
Peuh! Nous revendiquons le titre de SECTE. Nous vénérons
le Cynisme et les Idées Noires, nous adorons faire peur aux Bien
Pensants, nous nous méfions des personnes d'humeur égale.
Fort heureusement, les gens de bonne humeur sont de grands pudiques: ils
ont leurs coups de barre comme les autres, qu'ils ne montrent pas. Nous
les invitons à rejoindre les Ventilationnistes, derniers des Bouffons.
L'hallux
valgus est pour le podologue,
l'anus vastus est pour le proctologue.
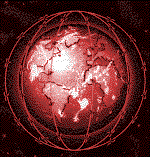
Réseau

Recherches
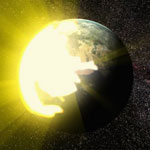
Rayonnement
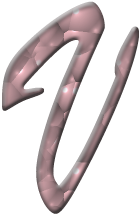
Amours barbares
25/11/04 par le Pr H.P. Mosis, défenseur
en herbe
Par une journée pluvieuse de l'été 450, le roi
Attila reçut un curieux émissaire en provenance de Constantinople.
Il s'agissait d'un gros homme jaune à la voix haut perchée,
aux cheveux poudrés, aux doigts boudinés disparaissant
sous les bagues. Sa toge d'apparat lourdement brodée ne portait
aucunement les traces du long voyage qu'il venait de faire avec sa petite
escorte de dix cavaliers. Mais la sueur et la poussière du chemin
dessinaient fortement un entrelac de rides autour de chacun de ses yeux.
Un léger tremblement de la lèvre le faisait finalement
paraitre pitoyable alors qu'il attendait devant le palais en rondins,
ses pieds chaussés de babouches délicates enfoncés
dans un mélange de boue et de déjections porcines et aviaires.
La capitale des terribles Huns était située à l'extrémité
orientale de l'ancienne province romaine de Pannonie, dans une vaste
plaine au pied des monts de Zemplen, à l'emplacement actuel de
la ville de Tokay en Haute-Hongrie, réputée pour ses vignobles
prestigieux.
Mais à cette époque sombre et anarchique, il n'y avait
ni vignobles, ni cultures. L'émissaire replet qui avait dû
franchir les montagnes des balkans et remonter pendant des jours sous
des orages le cours du Danube jusqu'aux vastes plaines alluviales et
sablonneuses de l'ancienne Pannonie, n'avait rencontré que ruine
et désolation. Il était impossible d'imaginer que moins
de dix années plus tôt, des villes imposantes et prospères
telles que Sirmium, Ratiara, Marcianopolis et Sardica assuraient d'agréables
étapes aux voyageurs. Même la trace de leurs fortifications
avait été effacée du sol calciné. Les paysans
de ces régions racontaient encore, en baissant la tête,
les massacres effroyables de femmes, d'enfants, de vieillards et de
soldats qui furent perpétrés pendant ces sièges.
Ayant fait preuve d'une cruauté insoupconnable à l'entendement
de leurs victimes ramollies par le luxe et les vices de la civilisation
byzantine, les barbares gagnèrent un respect servile et craintif
chez les survivants.
L'effrayante multitude des Huns (on disait qu'Attila disposait d'une
armée de sept cent mille hommes avec laquelle il avait semé
la terreur de la mer d'Azov aux rivages de la Baltique et de l'Hellespont)
se tenait tranquille depuis qu'elle avait obtenu un vaste territoire
et un tribut annuel de deux milles livres d'or à la signature
en 446 du traité de paix avec le faible Empereur d'Orient, Théodose
II.
Ce peuple de nomades qui avait fait vaciller l'ordre mondial était
maintenant regroupé dans une immense ville de tentes et de chariots
au milieu desquels s'élevaient les maisons des dignitaires, des
femmes favorites et l'austère palais de bois sculpté construit
sur une éminence d'où il dominait le camp tout entier.
Lorsqu'Attila donna audience au gros homme, celui-ci lui révéla
qu'il n'était pas un envoyé officiel mais un œnuque
au service de la princesse Honoria. L'émissaire lui remit une
bague ayant appartenu à la princesse, un foulard de soie parfumé
et un message lui conjurant de la demander comme légitime épouse.
A ces mots, les petits yeux enfoncés dans la tête difforme
et basanée du roi des Huns se mirent à rouler dans leurs
orbites. D'une démarche fière qui annoncait bien son sentiment
de supériorité sur l'ensemble du genre humain, Attila
fit quelques pas en se grattant une affreuse barbiche plantée
au milieu du menton. Une excitation commencait à faire palpiter
son pelvis de loup des steppes. Que pouvait bien signifier cette demande
? Honoria ! La sœur de Valentinien III, empereur romain d'Occident.
Un empire qu'il convoitait depuis des années, surtout les bonnes
terres grasses de la province de Gaule. Honoria, réputée
jadis pour son exquise beauté et la chaleur torride de son tempérament...
Attila savait qu'elle était retenue en captivité depuis
dix ans dans un couvent de Constantinople après qu'elle se fut
trouvée grosse à seize ans des œuvres de son chambellan
Eugène. L'empereur son frère, avait préféré
l'éloigner de Ravenne, cour impériale d'Occident depuis
que Rome avait été saccagée par les Goths. Les
mauvaises langues disaient que son bannissement n'avait aucunement éteint
les ardeurs amoureuses de la princesse. Attila, qui possédait
déjà plusieurs dizaines de femmes jaunes et épaisses,
aux forts relents de musc et de lait caillé, et poilues comme
des truies de vikings, se sentit soudain furieusement flatté
d'avoir enflammé ainsi, par sa simple renommée, le cœur
d'une telle femme, une femme dont la subtilité prévisible
des effluves charnelles et des étreintes satinées commençait
déjà à perturber gravement son intelligence. Il
se déclara aussitôt l'amant et le défenseur de la
princesse Honoria.
Alors que l'émissaire-œunuque venait tout juste de prendre
le chemin du retour, Attila envoya ses ambassadeurs bride abattue à
Constantinople porter une déclaration par laquelle il demandait
la main de la princesse ainsi que la part à laquelle elle avait
droit de prétendre dans le patrimoine impérial.
Mais pendant ces quelques semaines, les choses avaient changé
dans l'empire d'Orient. L'empereur Théodose II qui avait fait
crouler son peuple sous les impôts, dilapidant le trésor
impérial en faste inutile et en dons envers ses favoris, qui
avait rougi, tremblé et baissé la tête sous les
insultes des barbares, venait de mourir des suites d'une chute de cheval.
Marcien, son beau-frère, monta sur le trône le 25 aout
450. Il possédait le courage qui avait manqué à
son prédécesseur et cette fois, les ambassadeurs d'Attila
reçurent un refus ferme. Honoria, quant à elle, fut immédiatement
renvoyée en Italie pour y être enfermée dans une
obscure prison de Ravenne, traitée comme une vulgaire espionne
qui avait tenté de pactiser avec les hordes de Huns. Ravenne
était une forteresse imprenable. Aucun chef barbare ne serait
assez fou pour venir y installer un siège, a fortiori pour une
simple histoire de fesses.
Mais Attila n'était pas homme à se soumettre. Profondément
humilié par ce refus et tenant là l'aiguillon lubrique
pour se remettre en selle, il annonca publiquement son intention d'envahir
la Gaule. Ce choix paradoxal obéissait à une stratégie
réfléchie. Le roi des Huns n'était certes pas cet
homme cruel et répugnant que la légende nous a dépeint,
dormant sur son cheval, se nourrissant d'ail et de chair crue, ne se
lavant jamais et affectionnant les massacres les plus abominables. C'était
un maître équitable et indulgent, un diplomate habile qui
savait tenir parole, un grand rassembleur de peuples hétéroclites
dont il savait se faire respecter et un chef de guerre remarquable qui
ne se lancait pas tête baissée dans des batailles meurtrières.
Comme tout chef barbare de l'époque, il était fasciné
par l'Empire qu'il combattait faute de pouvoir y être intégré
avec les honneurs. Son secrétaire d'état était
un haut fonctionnaire romain nommé Oreste. Le général
Aetius, l'homme le plus illustre et le plus vénéré
de son temps, celui qui avait la charge de soutenir les ruines prêtes
à s'écrouler de l'empire d'Occident, avait été
jadis son ami. Carpilio, le fils d'Aetius, fut élevé dans
le camp d'Attila. Des bataillons de Huns avaient même combattu
quelque temps dans les rangs de l'armée romaine d'Aetius pour
repousser les invasions vandales et suèves.
Mais beaucoup de temps avait passé. Attila était poussé
à la guerre par son peuple et par la fédération
de barbares alliés dont la seule source d'enrichissement était
le pillage des villes conquises. L'Empire Romain d'Orient, ravagé
et humilié par des traités ruineux, ne représentait
plus une proie intéressante. La Gaule, elle, était fertile,
riche et militairement affaiblie. De plus, Attila savait que s'il voulait
vaincre l'Empire Romain d'Occident et voir tomber Ravenne comme un fruit
mûr, il lui faudrait d'abord écraser Aetius, le défenseur
des Gaules.
En cette année 450, l'autorité romaine avait beaucoup
de mal à se maintenir sur le territoire gaulois. Les grands propriétaires
terriens, inquiets des invasions et convaincus que les légions
n'étaient plus capables d'assurer leur sécurité,
avaient appelés eux-mêmes certaines tribus barbares pour
les défendre. Celles ci recevaient en échange un tiers
ou la moitié du sol ou des revenus
du sol, ce qui était souvent moins lourd que les impôts
levés par Ravenne. C'est ainsi que les Alains s'étaient
installés dans les vallées de la Loire et du Rhône
et que les Burgondes occupaient, à titre "d'hôtes"
les vallées de la Saone, de la Drome et toute la région
du lac Léman. Tout le sud-ouest était occupé par
les Wisigoths dont le royaume avait acquis force et solidité
sous la conduite du roi Théodoric et dont l'armée était
la plus puissante de Gaule. Mais Théodoric avait son attention
détournée ailleurs, tout occupé qu'il était
à organiser une expédition en Afrique pour venger sa fille
défigurée par le roi des Vandales. Quant aux Francs, ils
règnaient sur la petite ville de Tournai en Belgique. et leur
roi Mérovée, qui avait conclu un traité avec Aetius
pour la défense commune de la Gaule, était très
critiqué dans son propre camp.
L'histoire officielle dira qu'Attila avait déjà tout manigancé
bien avant les déclarations amoureuses d'Honoria et qu'il profita
de l'absence de Mérovée, en voyage à Ravenne, pour
s'allier avec le frère de celui-ci et faire passer le Rhin à
ses troupes. Mais certains chroniqueurs affirment qu'en réalité,
il était follement ulcéré par les refus successifs
de l'empereur Valentinien III à lui livrer la belle Honoria et
que la contemplation de portraits ainsi que la perspective obsessionnelle
d'accouplements salaces autant que libidineux avait fini par exciter
sa concupiscence au point de lui ôter tout appétit et tout
sommeil et de transformer cette irrépressible impétuosité
des sens en fureur guerrière. Sans les conseils de prudence de
son état-major, il se serait probablement rué sur l'Italie
du nord.
En automne 450, les Huns et leurs alliés traversèrent
le Rhin sur un pont de bateaux et déferlèrent sur les
provinces gauloises. La consternation fut générale. Les
villes de Troyes, de Tongres et de Metz furent livrées aux flammes.
A Metz, les prêtres et les enfants qui s'étaient réfugiés
dans l'église furent massacrés sans distinction tant la
rage d'Attila avait atteint son acmé après une épuisante
autant que stérile nuit de compulsion onanique effrénée.
La ville fut si bien rasée que les survivants s'empressèrent
de construire une petite chapelle pour se rappeler l'emplacement qu'elle
occupait. A Tongres, ils découpèrent en morceaux tous
les habitants après en avoir lu l'injonction dans l'examen d'entrailles
d'un foetus retiré à l'épée du ventre chaud
et palpitant de sa mère. Puis les Huns traversèrent la
Seine à Auxerre et marchèrent sur Orléans, dédaignant
Lutèce où une folle nommée Geneviève faisait
l'hytérique sur les remparts. Orléans était un
poste important qui contrôlait toute la riche région de
Loire et les tribus d'Alains qui y étaient installés avaient
promis aux espions d'Attila de trahir les romains et de lui livrer la
ville. Mais la conspiration fut découverte et les habitants d'Orléans
se préparèrent courageusement au siège, amassant
des réserves et consolidant en toute hâte les fortifications
de la ville. Les Huns s'épuisèrent en assauts successifs
qui furent tous repoussés.
Sous sa tente royale, Attila, de plus en plus frappadingue, tournait
en rond comme un singe en rut, bourrinant et rebourrinant en songe l'étui
voluptueux de sa dulcinée.
Les semaines passèrent. Profitant de ce délai, le général
Aetius, en manque de soldats, parvint à convaincre Théodoric,
le roi des Wisigoths, de surseoir à sa campagne d'Afrique et
d'associer son armée aux légions romaines pour sauver
le territoire gaulois. Le sort de la Gaule toute entière était
bien dans les mains de ce roi toulousain, ancien barbare romanisé,
bel homme aux cheveux longs et aux joues rasées de près,
dont les ançêtres crasseux avaient fui jadis devant les
cavaliers des steppes.
Ce fut le jour même où les Huns ouvrirent enfin une brèche
dans les remparts d'Orléans que les escadrons d'Aetius et de
Théodoric apparurent à l'horizon. Bien évidemment,
Anianus, l'évèque de la ville, fit passer cela pour un
miracle. Attila, lorsqu'il vit l'énorme nuage de poussière
soulevé par les coalisés, préféra lever
le siège et fit sonner la retraite. Il repassa la Seine, imposant
un rythme effréné à ses hommes et alla attendre
l'ennemi dans les plaines de Châlon où sa cavalerie pourrait
maneuvrer avec plus de facilité.
Le 20 juin 451, les deux armées se rencontrèrent aux Champs
Cataloniques.
Dans l'aube d'un matin gris, avant de disposer ses troupes en ordre
de bataille, Attila, les yeux creux, le teint terreux et la lippe spumeuse,
harangua longuement ses hommes qui commencaient à craindre l'affrontement.
Il leur révéla que l'examen des entrailles et des os d'un
soldat avait prédit la mort du roi Théodoric, leur plus
redoutable ennemi, et qu'ils n'auraient rien à craindre des bataillons
romains qui ne savaient plus supporter les fatigues et les dangers d'une
bataille. Il leur assura que les dieux les protègeraient des
dards de leurs ennemis. Il appela tour à tour ses lieutenants,
leur parla de leurs anciens exploits, du danger présent et des
récompenses à venir. Puis ils se mirent en ordre de combat.
Tous les peuples, depuis la Volga jusqu'à l'Atlantique étaient
représentés, attroupements d'hommes aux cheveux longs
resserrés en natte, torse nu pour la plupart et simplement armés
de lances et de boucliers. Seules les légions romaines, équipées
de pied en cap, donnaient un semblant d'ordre aux deux terribles masses
humaines qui s'avançaient lentement l'une vers l'autre. La bataille,
telle que la décrivit l'historien Cassiodore, fut "terrible,
longtemps douteuse, opiniâtre et sanglante, telle qu'on n'en avait
point vu dans les siècles précédents". Une
première charge de cavalerie des Huns fut stoppée net
par une pluie de flèches et de javelots. Une deuxième
charge réussit à percer le centre de la coalition romaine
et, dans un mouvement d'enroulement rapide, isola l'aile gauche occupée
par les wisigoths.
Pendant ce temps, les infanteries des deux armées se mélaient
dans un terrible corps à corps. A la tête de sa cavalerie,
Attila semait la panique dans les rangs des wisigoths. Théodoric,
qui galopait en tous sens pour ranimer l'ardeur de ses soldats, tomba
soudain de son cheval, mortellement blessé par un jet de javelot.
Dans le désordre qui s'ensuivit, le roi défunt fut piétiné
par ses troupes en déroute et les sabots de la cavalerie barbare.
Mais les Huns, croyant la partie gagnée, mirent leurs flancs
à découvert et le vaillant Torismond, lieutenant d'Aetius
retourna brusquement la situation en déferlant sur eux avec des
troupes fraiches et bien organisées. Seule la tombée de
la nuit sauva Attila d'une défaite totale. Une bonne partie de
ses alliés, Hérules, Thuringiens et Gépides, avait
déjà fui le champ de bataille où des milliers de
blessés lancaient des hurlements de bête, griffaient la
terre, s'emplissaient la bouche et les narines de boue et s'arrachaient
les yeux pour ne plus voir cet amas de viande humaine agonisante dont
ils faisaient partie. Les Huns se réfugièrent derrière
un rempart de chariots et Attila fit dresser un bûcher formé
de selles de chevaux pour être prêt à se précipiter
dans les flammes si l'ennemi forçait son camp. Mais les romains,
dans la confusion du combat, ne voyant plus Aetius qui s'était
déporté trop loin sur la gauche et entendant des soldats
crier la mort de Torismond, se retirèrent dans leur camp.
Une fois le calme revenu, de part et d'autre, on dressa le bilan. Cent
soixante, peut-être deux cent mille morts... Sans compter les
blessés, que l'on entendait gémir dans la nuit et que
personne n'osait aller secourir... Torismond, celui qui avait retourné
le cours de la bataille, regagna finalement ses lignes au milieu de
la nuit, une jambe fracassée, et fut acclamé en héros.
Le lendemain, les Wisigoths enterrèrent et pleurèrent
leur roi. Derrière l'enceinte de leurs chariots, les Huns ressemblaient
à des lions rugissants harcelés par les chasseurs, tapant
de l'épée sur leurs boucliers et poussant des hurlements
à glacer le sang. Pendant plusieurs jours, les deux camps se
firent face sans oser à nouveau livrer bataille. Et un matin,
les Huns se réveillèrent surpris du profond silence qui
régnait sur les plaines de Châlon. Aetius et ses troupes
s'étaient retirés pendant la nuit, abandonnant les Huns
à leur demi-défaite. Plus tard, Aetius confia qu'il avait
craint de rendre, par la destruction des Huns, la puissance des Wisigoths
trop redoutable. Peut-être ses anciens liens d'amitié lui
avaient également dicté de ne pas porter le coup fatal
à Attila.
Ayant perdus trop d'hommes, les Huns se replièrent et repassèrent
le Rhin. Au passage, ils se vengèrent sur les Francs qui avaient
rejoint le camp romain sous l'impulsion de Mérovée.
Les habitants des villages traversés furent écartelés
par les chevaux, écrasés par les roues des chariots, et
leurs membres éparpillés au bord des routes. A Tournai,
capitale de Francs, deux cent jeunes vierges furent rassemblées,
livrées à l'ardeur des soldats en rut et finalement passées
au fil de l'épée.
Arrivé en Pannonie, Attila, fou de rage, reconstitua ses troupes
en décrétant la mobilisation générale et,
de plus en plus habité par ses démons concupiscents, demanda
une nouvelle fois aux romains de lui livrer la princesse Honoria. Comme
on ne lui répondait pas, il passa les Alpes au printemps 452
et envahit l'Italie du nord sans plus tenir aucun compte des conseils
de modération de son état-major.
Mais cette fois, la fortune sourit à l'audacieux. Aetius, revenu
de Gaule, eut toutes les peines du monde à lever une nouvelle
armée. Il faut dire que les romains avaient depuis longtemps
renoncé au métier des armes. Les plaines du Pô furent
ravagées. Aquilée, autre place forte réputée
imprenable fut rasée, ainsi que Pavie, Milan, Vérone et
Bergame. Les habitants de la Vénétie se réfugièrent
sur les îles d'une lagune et fondèrent la république
de Venise. Devant l'approche du danger, le pleutre Valentinien III et
sa cour firent la grave erreur de quitter Ravenne pour Rome, emmenant
une Honoria toute excitée dans leurs bagages. Attila, son champion,
son guerrier à l'arbalète lustrée, venait la délivrer
et lui pourfendre la rosette de son gaillard gourdin.
Comme les barbares approchaient de l'ancienne capitale impériale,
le sénat se dépécha d'envoyer à Attila une
ambassade solennelle menée par Léon, évèque
de Rome. La rencontre eut lieu sur les bords du lac Benacus, non loin
de la ville de Mantoue. L'éloquence de Léon, son allure
prestigieuse et ses habits pontificaux impressionnèrent vivement
le roi des Huns. La légende dira plus tard qu'au moment où
Léon s'avanca vers les barbares en leur faisant un signe de paix,
un terrible orage éclata dans le ciel tandis que les nuées
dessinaient la silhouette d'un viel homme furieux jetant des poignées
d'éclairs sur la terre. Au seizième siècle, le
jeune peintre florentin Raphaël représenta l'évènement
par une fresque que l'on peut encore voir au palais du Vatican. La silhouette
nuageuse y est remplacé par saint Pierre et saint Paul, le glaive
à la main, faisant se cabrer le cheval d'Attila et mettant en
fuite les Huns affolés dont l'enchevètrement des lances
penchées vers la droite contraste fortement avec la verticalité
de la croix catholique tenue par le commandant de la garde impériale.
Comment ajouter foi à cette représentation manichéenne
de l'Ordre et du Chaos face à face ? Que s'est-il réellement
passé ce jour là ? Qu'a pu bien dire Léon à
Attila qui le fasse rebrousser chemin aux portes de Rome ? Les historiens
auront beau jeu d'expliquer que la peste sévissait dans les rangs
de l'armée des Huns et que la lecture des entrailles avait prédit
la mort d'Attila s'il s'avisait de conquérir la Ville Eternelle,
ce ne sont là que des explications partielles.
Quoi qu'il en soit, le lendemain de cette entrevue, Attila reprenait
la route de Pannonie et les vieux livres deviennent curieusement muets
sur le sort de l'infortunée Honoria, tout se passant exactement
comme si une transaction avait eu lieu et que Léon ait échangé
la princesse contre la promesse du retrait des barbares.
Il convient d'extirper maintenant de la poussière des siècles
les pages du journal d'un soldat Bagaude qui combattait dans l'armée
barbare.
Celui ci s'étonne que le roi des Huns demeura enfermé
dans son charriot tout le chemin du retour, bombant et ripaillant avec
une telle force que le vacarme s'en répandait dans tous les rangs
de son escorte et que de nombreux rires et gloussements de femme furent
même distinctement entendus bien que toutes les épouses
du roi fussent restées en Pannonie. Mais les hommes frustes de
l'époque, accoutumés aux manifestations surnaturelles,
se dirent que la déesse Diane était descendue du Panthéon
pour accorder au conquérant de l'univers un peu d'apaisante félicité.
Tous ces soldats qui révaient de s'approprier les richesses de
Rome, suivaient maintenant sans broncher leur roi dans sa volte-face.
La puissance persuasive de Léon avait-elle été
à ce point efficace sur ces milliers de barbares prêts
à piller la Ville Eternelle ?
Le voyage dura vingt jours, vingt longues journées à travers
les Alpes pendant lesquels les soldats n'apercurent point leur maître.
Mais pour l'entendre, ils l'entendirent, tout au moins les hommes de
la garde rapprochée. Le Bagaude relate que de son chariot, Attila
criait en latin, qu'il maitrisait parfaitement mais utilisait rarement,
des phrases telles que : "Ad costem tibi septimam recondam !"
(Je te l'enfoncerai jusqu'à la septième côte), ou
: "Secti podicis usque ad umbilicum !" (Je vais te fendre
le cul jusqu'au nombril). L'excès de spasmes graveleux amena
plusieurs fois Attila au bord de l'apoplexie syncopale. C'est du moins
ce que rapporte le soldat Bagaude qui vit plusieurs fois le médecin
de la troupe monter dans le chariot royal pour procéder à
des saignées salvatrices. Questionné de toutes parts sur
ce qu'il aurait pu voir, le médecin avait fini par lâcher
d'un air sarcastique : "Mentula cum doleat puero, illa culus, non
sum divinus, sed scio quid faciat." (Quand ce garçon se
plaint d'avoir mal à la queue et elle au cul, je ne suis pas
devin, mais je sais ce qu'ils ont fait.). Et qui pouvait donc être
d'autre cette femme que la princesse Honoria en personne ?
Mais la suite de l'histoire semble apporter un démenti cinglant
à cette séduisante hypothèse : à peine arrivé
dans son camp, Attila
décide d'épouser sur le champ une jeune beauté
barbare nommée Idlico qui était venue l'acceuillir avec
un groupe d'adolescentes nubiles. Le soir de ses noces, accablé
de vin et de fatigue, il quitte fort tard les plaisirs de la viande
pour se livrer à ceux de la chair. Le lendemain, la journée
touche à sa fin quand les serviteurs, inquiets du silence, se
précipitent dans la chambre de leur maître. Il trouvent
Attila sur le sol froid, étouffé par son sang et la jeune
épouse, qui semblait avoir vieilli de dix ans, assise tremblante
au bord du lit.
Alors, selon la coutume, ils coupèrent une partie de leurs cheveux,
et se firent au visage de profondes blessures pour pleurer, non avec
des larmes comme des femmes, mais avec leur sang. Le corps d'Attila,
enfermé dans trois cerceuils, le premier d'or, le second d'argent
et le dernier de fer, fut mis en terre et recouvert de trophées,
de pierres précieuses et d'ornements divers ainsi que des corps
des prisonniers qui avaient creusé la tombe. Les Huns terminèrent
la fête en se livrant autour du sépulcre à tous
les excès de la peine et de la débauche. Ainsi finissaient
un règne de dix neuf ans et la suprématie du peuple des
Huns sur les nations de la Scythie et de la Germanie
Un an plus tard, en 453, Aetius, celui qui avait laissé la vie
sauve à Attila aux Champs Cataloniques et qui n'avait pas su
empêcher l'invasion de l'Italie du nord, était assassiné
par la main même de l'empereur Valentinien III, lequel fut massacré
peu de temps après par des soldats vengeurs.
En 476, Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident, était
déchu de ses fonctions par un général barbare nommé
Odoacre. Par une dérision du destin, ce jeune empereur déchu
était le propre fils d'Oreste, l'ancien secrétaire d'état
d'Attila.
Vingt ans plus tard, Clovis, le petit-fils de Mérovée,
étendait le royaume franc à toute la Gaule déromanisée.
En 498, alors que Clovis se faisait baptiser à Reims par l'évèque
Rémi, la dernière femme d'Attila, celle que l'on nommait
Idlico, rendit l'âme sur les bords de la mer Noire où Dengisich,
dernier fils vivant du roi des Huns, s'était réfugié
après avoir été chassé de ses territoires
par les Gépides et les Ostrogoths.
Idlico, sur son lit de mort, prétendit qu'elle était la
princesse Honoria. D'une voix entrecoupée par les spasmes de
l'agonie et de la honte mélés, elle raconta à sa
dame de compagnie quel genre de partie triangulaire s'était réellement
déroulée la nuit où Attila, terrassé par
un excès de volupté, s'était éteint, et
comment, de rage, elle avait tuée et enterrée de ses propres
mains dans le sol glaiseux de la tente royale la jeune fille qu'ils
avaient voulu associer à leurs insatiables étreintes.
L'histoire fut rapportée dans tout le campement. Personne ne
la crut et la vieille femme fut enterrée sans tumulus, sans ornement
funéraire et sans nom, à l'emplacement exact qu'occupe
actuellement un immeuble sale de trois étages dans la petite
ville balnéaire de Sozopol en Bulgarie.
H.P.MOSIS 1995
VIOQ
L’étude qui fait trembler le corps médical
Cette étude menée pendant 10 ans dans le
comté de Freemantle (état du New Jersey) sur des personnes
âgées de 85 à 105 ans est une première par
son originalité et ses conclusions. Baptisée VIOQ (Vivacity
Impertinent Oldsters Quotas), elle avait pour but de corréler
la longévité et la bonne santé de cette tranche
d’âge au suivi médical et hospitalier. Les résultats
sont consternants pour le milieu médical. Il apparaît en
effet que la longévité exempte de pathologies graves est
inversement proportionnelle au nombre de consultations, et ceci, d’une
façon d’autant plus nette que l’âge est élevé.
Dans la tranche de 85 à 90 ans, les personnes en excellente santé
ne prenant aucun traitement au long cours consultent en moyenne de une
à trois fois par an et n’ont pas subi plus de trois bilan
sanguins ou consulté plus de 5 fois avant l’âge de
70 ans (en dehors des accouchements). Dans la tranche d’âge
de 100 à 105 ans, les statistiques sont encore plus surprenantes
: seul 1% des centenaires a eu recours à la médecine,
et pour des motifs mineurs (furoncle, suture d’une plaie, piqure
d’insecte). Aucun vielliard en bonne santé dans la tranche
d’âge au delà de 90 ans n’a subi de coloscopie,
de dosage des antigènes prostatiques, ou même une simple
radio pulmonaire au long de toute sa vie.
Doit-on en conclure que la longévité de nos seniors ne
doit rien aux progrès de la médecine moderne ? Le débat
est ouvert. Déjà, certains esprits critiques avaient fait
remarquer que tous les grands hommes de l’antiquité atteignaient
un âge canonique (Platon, Aristote, etc…) lorsqu’ils
n’étaient pas empoisonnés (Socrate) ou tués
sur un champ de bataille. D’autres études avaient également
laissé suggérer que la longévité était
plus le fait d’un état d’esprit particulier (optimiste,
curieux et non-conformiste) plutôt que la dépossession
de sa santé au profit d’un corps médical toujours
enclin, quelle que soit l’époque, à des excès
fâcheux dans la recherche de l’efficacité.
25/11/04 par ES
Emigré
hongrois vivant aux Etats-Unis depuis 1966, le docteur Potlatsch est à
l’origine d’une découverte stupéfiante que la
communauté scientifique cherche par tous les moyens à garder
sous silence. Ayant mené une existence d’ascète, ce
sympathique pédiatre fut assez dépité lorsqu’on
lui diagnostiqua, en avril 1992, alors qu’il atteignait ses 52 ans,
une tumeur du larynx de fort mauvais pronostic. Atteint par le désespoir
et peu décidé à accepter un traitement conventionnel
délabrant, il décida de mettre fin à ses jours. Pour
ce faire, il s’enferma dans son appartement du lower east side,
à Manhattan, avec une caisse de bon vin de Bordeaux, une cartouche
de cigarettes, des tranquilisants et une arme de poing. Après une
nuit de libation solitaire et de tabagisme compulsif, il s’endormit
fort heureusement avant de se tirer une balle dans la tête. Lorsqu’il
sortit de son état comateux deux jours plus tard, il se sentit
étrangement mieux et sa voix avait repris le timbre de sa jeunesse.
Dans la semaine qui suivit, il fit des tests de contrôle au centre
de cancérologie. Quelle ne fut pas la stupéfaction des spécialistes
lorsqu’ils constatèrent que toute trace de tumeur avait disparu
!
Depuis, le docteur Potlatsch milite en vain pour faire reconnaître
sa méthode pour le traitement des cancers de la sphère ORL,
ce qui lui a valu plusieurs internements en milieu psychiatrique et des
menaces de mort de l’industrie pharmaceutique.
Sa méthode est d’une simplicité déconcertante
: après trois semaines d’un régime hypocalorique strict
enrichi en vitamines anti-oxydantes et associé à une activité
physique intense, il faut s’administrer dans un délai de
trois heures deux à trois bouteilles d’un bon vin français
en inhalant la fumée d’une cinquantaine de cigarettes.
Le traitement agirait par l’effet anti-cancérigène
des flavonoïdes contenus dans la peau de raisin rouge, associé
à une privation d’oxygène tumoral du fait de la surcharge
de l’hémoglobine en oxyde de carbone. Un effet nécrotique
direct sur la tumeur lié au benzène et aux goudrons contenus
dans le tabac n’est également pas à exclure.
Le traitement est d’autant plus efficace que les sujets ne sont
pas alcoolo-tabagiques compulsifs, mais il semble qu’un arrêt
complet de trois semaines avant la cure soit suffisant.
20/11/2004 par ES